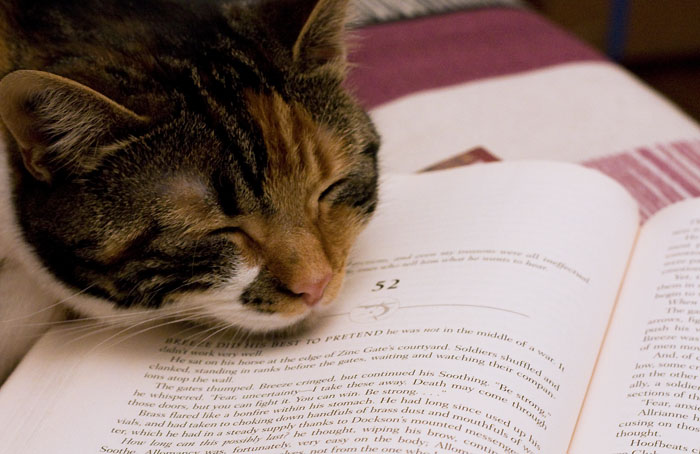
Une fois n’est pas coutume, envie de recopier ici tel quel ce texte publié l’autre jour sur Facebook, sur un coup de tête, et qui semble avoir trouvé des échos chez pas mal d’autres personnes, si j’en crois le nombre de commentaires, messages et témoignages que j’ai reçus depuis. Une réflexion que je me suis souvent faite ces quinze dernières années, et qui semble de plus en plus vraie. La façon dont on “consomme” la culture à l’heure actuelle, avec la notion d’immédiateté qui l’accompagne, ne fait à mon sens qu’accentuer les choses.
Pas mal de questionnements ressortent en cette semaine doublement symbolique pour moi, entre la réduction prochaine des doses du médicament qui m’a permis de tenir debout depuis le burn-out de l’automne dernier, et l’arrivée de l’étape que j’ai tellement attendue pendant ces neuf mois : celle où je n’ai plus ni projets en attente, ni chroniques ou interviews à préparer, ni nouvelles ou articles à écrire pour une date fixe, “juste” la traduction en cours, soit le boulot qui paie les factures et auquel je vais donc réellement pouvoir me consacrer à temps plein.
Je me dis qu’il faudrait un jour écrire noir sur blanc à ce sujet, mais je trouve de plus en plus insidieux, dans les métiers de la création, l’interdiction qui nous est faite de nous arrêter. Pas seulement pour des questions financières (rappelons que les indépendants n’ont ni congés payés, ni droit au chômage), mais une idée bien ancrée dans les esprits selon laquelle un artiste doit créer tout le temps, sans exception. Le pire étant pour moi la façon dont on finit par l’intégrer, en se disant que “les autres y arrivent”, que “c’est moi qui suis incapable d’assurer”, jusqu’à ce que la corde sur laquelle on tire finisse par lâcher. Au point que je me retrouve gênée d’admettre, quand on me pose la question, que je n’ai pas écrit de nouvelles depuis “La clé de Manderley” en août dernier, avant de me rappeler qu’il y a de très bonnes raisons à ça (projets chronophages, énergie réduite et nécessité de privilégier ce qui payait les factures). Au point que je suis gênée d’avouer que je ne veux pas envisager la reprise de l’écriture avant au moins l’automne. Parce que “faire une pause”, “recharger ses batteries”, vivre un peu entre deux textes en essayant de ne pas s’épuiser, ce n’est pas une réponse recevable.
Sans doute qu’on n’est pas égaux face à l’énergie qu’on est capable d’injecter dans la création, et sans doute que j’y suis plus sensible depuis l’an dernier. Mais je songe de plus en plus qu’il y a là une forme de tabou qui peut miner autant que la précarité associée à ces métiers. Sentir qu’on passe pour une feignasse quand on cherche simplement à trouver comment avancer au mieux n’est pas toujours très agréable. Et j’aimerais sincèrement comprendre un jour pourquoi, dans l’esprit des gens, l’idée même d’une pause passe pour de la paresse ou un caprice dès lors qu’on a fait le choix d’un chemin passant par la création. Et pourquoi, à force de se faire (plus ou moins gentiment) vanner sur le sujet, on finit par y croire soi-même.

9 commentaires pour “De l’interdiction de s’arrêter”