
(Cet article est initialement paru sur Le Cargo. Pour ceux que le sujet intéresserait, l’ensemble de mes chroniques pour le webzine est accessible ici.)
On s’en voudrait presque d’émettre quelques réserves sur cet ouvrage tant il s’agit d’un projet auquel on aimerait adhérer pleinement, et d’une initiative qu’on ne peut que saluer : remettre les femmes à leur juste place dans l’histoire du rock, trop souvent écrite par et à travers les hommes. Intention salutaire et nécessaire, aujourd’hui plus que jamais : en 2019, on entend encore beaucoup trop d’artistes évoquer les difficultés qu’elles rencontrent pour exister autrement que dans l’ombre des hommes, pour être reconnues comme créatrices à part entière plutôt que muses ou « chanteuses du groupe » ne connaissant rien aux aspects techniques, matériels ou financiers, et on sait combien les femmes restent minoritaires parmi les producteurs, directeurs de label – ou chroniqueurs musicaux, comme Sophie Rosemont, journaliste pour Rolling Stone, Paris Match ou Les Inrocks, le fait remarquer elle-même dans les remerciements de son ouvrage.
Les femmes à leur juste place
On s’en voudrait presque, donc, d’avouer que Girls Rock nous a à la fois enthousiasmés et pas totalement convaincus, nous laissant sur une double impression difficile à démêler. L’ouvrage a d’indéniables qualités, mais quelques points nous auront fait tiquer. Commençons par évoquer le positif : il se dégage de cette lecture une impression de grande générosité et une indéniable envie de partage et de transmission. De toute évidence, Sophie Rosemont se passionne pour le sujet, elle aime profondément les artistes qu’elle évoque, et cette admiration transpire de toutes les pages. Les musiciennes évoquées sont nombreuses et très variées, que ce soit en termes d’époque, de style musical ou de place généralement reconnue dans l’histoire du rock. On navigue à travers le temps, des pionnières Sister Rosetta Tharpe ou Bessie Smith à des artistes actuelles comme Angel Olsen ou Anna Calvi ; on revisite l’histoire des légendes Janis Joplin, Siouxsie Sioux, Nina Hagen ou Joni Mitchell comme on (re)découvre des parcours moins connus (Gladys Bentley ou Valérie Lagrange) ; la scène francophone n’est pas oubliée avec des pointures aussi diverses que Catherine Ringer, La Grande Sophie, Catherine Ribeiro ou Edith Fambuena.
En guise d’intermèdes, Girls Rocks invite de jeunes musiciennes actuelles à parler d’artistes qui les ont marquées, à travers des témoignages toujours touchants : Jeanne Added évoque l’écoute de Hole avant l’écriture de son premier album, là où Lou Doillon raconte une rencontre émue avec Patti Smith. Girls Rock fait le choix d’une construction thématique plutôt que chronologique, abordant le sujet sous plusieurs axes : les cavalières en solitaire (Kate Bush, Dolly Parton, PJ Harvey), les femmes fatales (Nico, Grace Slick, Stevie Nicks), les engagées (Joan Baez, Tori Amos, Liz Phair), celles qui se battent pour des questions d’identité de genre (Anohni, Beth Ditto, k.d. lang), ou encore celles au destin tragique (Amy Winehouse, Mama Cass, Dolores O’Riordan). Construction qui rend la lecture dynamique et vivante mais parfois un peu brouillonne lorsque les portraits, trop courts, s’enchaînent un peu vite. On éprouve parfois la frustration de ne pas s’attarder plus longuement sur certains de ces parcours, mais c’est la limite inévitable de l’exercice. Le livre replace chaque carrière dans son contexte plus global, dessinant en filigrane les évolutions sociétales – depuis l’évocation de la révolution des riot grrrls à Debbie Harry expliquant qu’à l’époque de son succès, Patti Smith et elle étaient les deux seules femmes du rock.
Intentions et interprétations
Venons-en maintenant à ce qui nous a gênés, en insistant sur le côté subjectif de cette réaction. Peut-être attendions-nous un ouvrage plus proche d’une encyclopédie de référence, davantage tendu vers une quête d’objectivité, mais il nous a semblé parfois que certains points de vues, certaines affirmations étaient sujets à caution, que ce soit dans l’interprétation des paroles, les suppositions quant au thème d’un album ou, de manière plus générale, l’explication donnée à la démarche de certaines artistes, parfois contredite par des interviews que nous avons pu lire ailleurs. Ainsi, on peut se demander si l’intention de Courtney Love, lorsqu’elle écrit « Violet », est réellement, comme on l’affirme ici, d’ordonner aux femmes d’apprendre à dire non – « Violet » ressemble plutôt à l’exorcisme d’une expérience personnelle qu’à un message adressé aux autres femmes (il est généralement supposé qu’il s’agit d’une chanson de rupture, ce que Courtney Love elle-même semble avoir déjà confirmé). À plusieurs reprises, il nous a semblé que les faits étaient légèrement tordus dans le but de coller à un discours pas forcément conforme à la réalité.
Par ailleurs, on avouera, en lisant les fiches consacrées à nos artistes préférées, ne pas les avoir nécessairement reconnues dans le portrait qui en était brossé. Les parties consacrées à PJ Harvey, dont votre matelote est une grande fan de longue date, nous ont notamment posé problème à plusieurs titres. D’une part, on peut s’étonner de la voir présentée comme une militante féministe acharnée dès ses débuts, quand on se rappelle au contraire qu’elle refusait farouchement l’étiquette à l’époque de Dry et Rid of Me, affirmant que le mouvement ne la concernait pas et ne l’intéressait pas. On peut effectivement choisir d’entendre ses premiers albums sous un angle féministe, tout comme on peut davantage y entendre l’expression intime d’un profond trouble existentiel – mais au final, chacun de ces points de vue n’est que spéculation. Il peut être tentant de voir en PJ Harvey une figure féministe importante, de par le modèle qu’elle a imposé et l’expression unique de la sexualité dans sa musique, mais en réalité, son rapport à ces questions-là était beaucoup plus trouble à ses débuts, ce qu’il aurait été plus honnête de préciser (contrairement à son engagement politique de ces dernières années qui, lui, est clairement revendiqué et que le livre mentionne très justement).
Portraits et subjectivité
Il nous a semblé par ailleurs relever quelques erreurs factuelles ou affirmations sorties de nulle part. L’ouvrage présente ainsi comme un fait avéré une relation avec Vincent Gallo qui n’a jamais été qu’une rumeur, et décrit Is this Desire ? comme le récit de la relation de l’artiste avec Nick Cave. Or, non seulement PJ Harvey ne s’est jamais exprimée dans ce sens, mais cette affirmation semble contredite par la matière même de l’album, qui se présente comme une suite d’histoires consacrées à des personnages féminins fictifs, toujours désignées par leur prénom. Quitte à spéculer, on peut éventuellement y deviner la figure de Sainte Catherine ou des références littéraires (« Joy » est souvent considérée comme inspirée par une nouvelle de Flannery O’Connor), mais on voit mal où pourrait bien être la place de Nick Cave dans tout ça.
Pour parler d’une autre artiste que nous admirons depuis longtemps, si l’on se réjouit de voir inclure Suzanne Vega souvent oubliée à tort dans ce genre de panoramas, on s’étonne de la voir réduite à une dimension solitaire qui n’est pas forcément le trait le plus saillant du personnage ni de sa carrière – et quitte à insister ailleurs sur la dimension féministe présente chez beaucoup d’artistes, le sujet aurait pu être creusé ici (on se rappelle notamment « I’ll Never Be Your Maggie Mae », réponse ironique à la dimension sexiste de la chanson de Rod Stewart, ou « Edith Wharton’s Figurines » sur la peur mortifère du vieillissement). Le choix d’un classement thématique oblige fatalement à mettre l’accent sur certains traits plutôt que d’autres, mais on en ressort avec l’impression que les portraits ne sont pas toujours très représentatifs, au point qu’on se demande ensuite en cours de lecture à quelles affirmations on peut se fier ou non pour les artistes dont on connaît moins bien le travail.
Déclaration d’amour
Ce genre de réaction est sans doute inévitable avec un tel ouvrage, qu’on aborde forcément avec sa propre subjectivité, son propre rapport au sujet, sa propre histoire intime avec les albums évoqués. Les quelques erreurs relevées nous ont surpris dans le sens où Sophie Rosemont semble très bien connaître la carrière des artistes évoquées, et en a d’ailleurs interviewé un certain nombre, mais on peut ne pas partager ses interprétations quant à leurs intentions. Reste qu’au final, il s’agit d’un ouvrage passionnant qu’on dévore d’une traite et qui donne de furieuses envies d’écoute – on se surprend ensuite à farfouiller dans la discographie des artistes qu’on connaît moins (votre matelote a passé hier quelques heures à creuser avec bonheur du côté de Sleater-Kinney, Joan Jett et Suzi Quatro). On ne peut au final que saluer la démarche militante, malheureusement toujours nécessaire, qui a donné naissance à cet ouvrage et, à condition de garder un certain recul face aux faits énoncés, on prend un grand plaisir à s’immerger dans cette lecture et à suivre les pistes qu’elle nous ouvre. Girls Rock est avant tout une sincère déclaration d’amour aux femmes qui ont fait l’histoire du rock, et un livre où transparaît un enthousiasme terriblement contagieux.

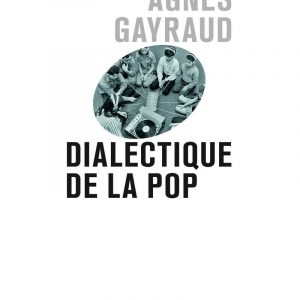
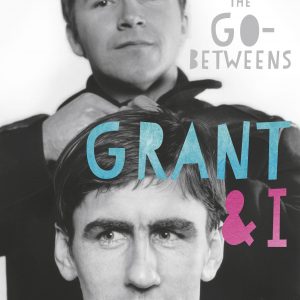 (Cet
(Cet 